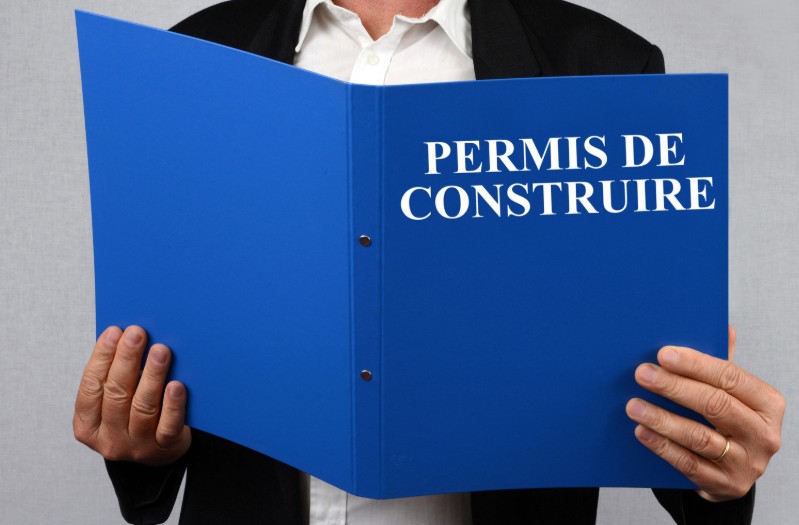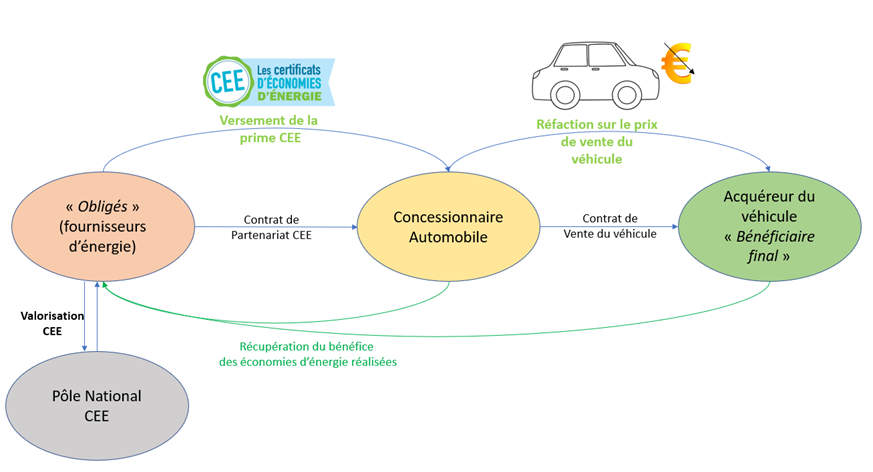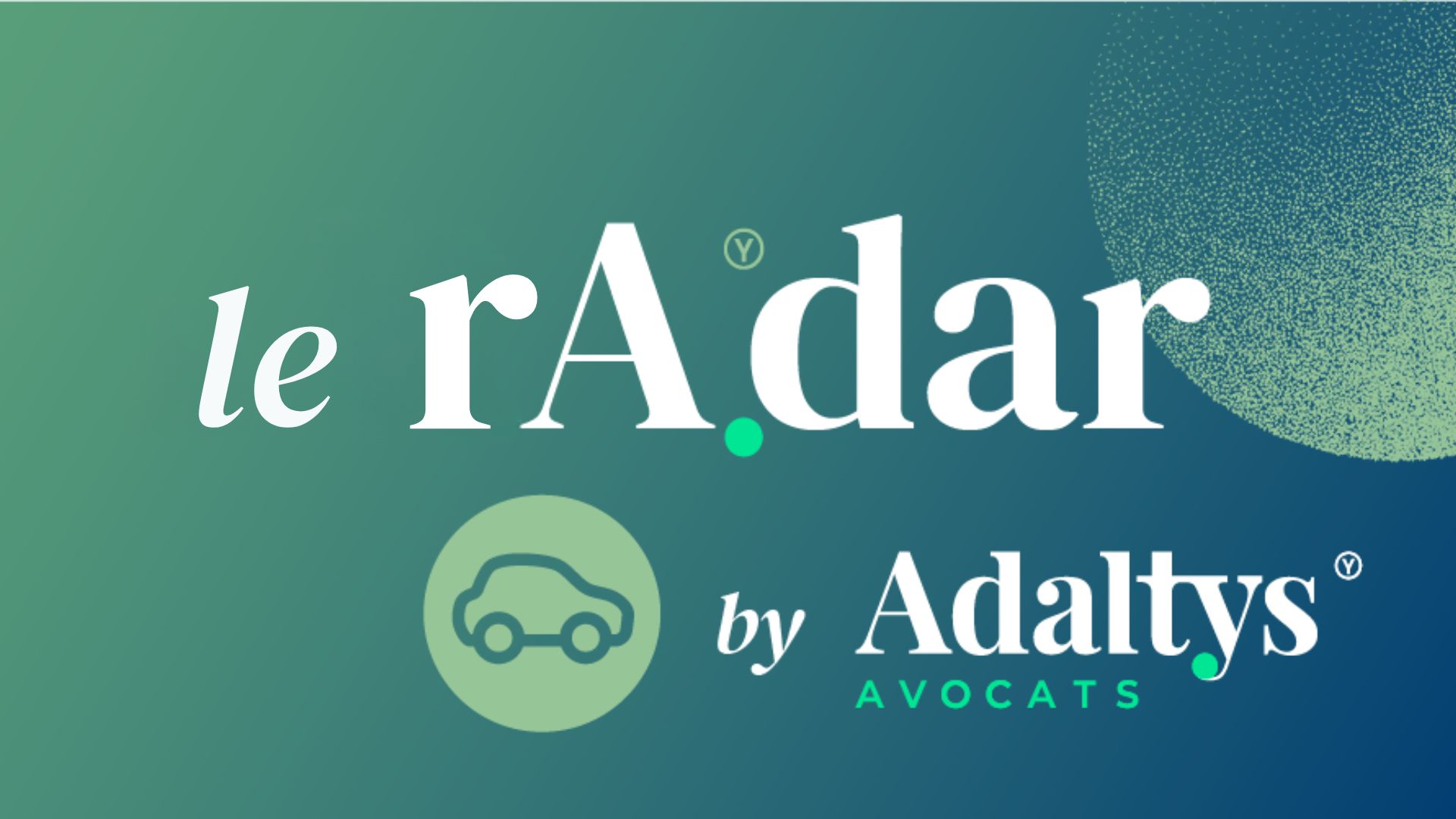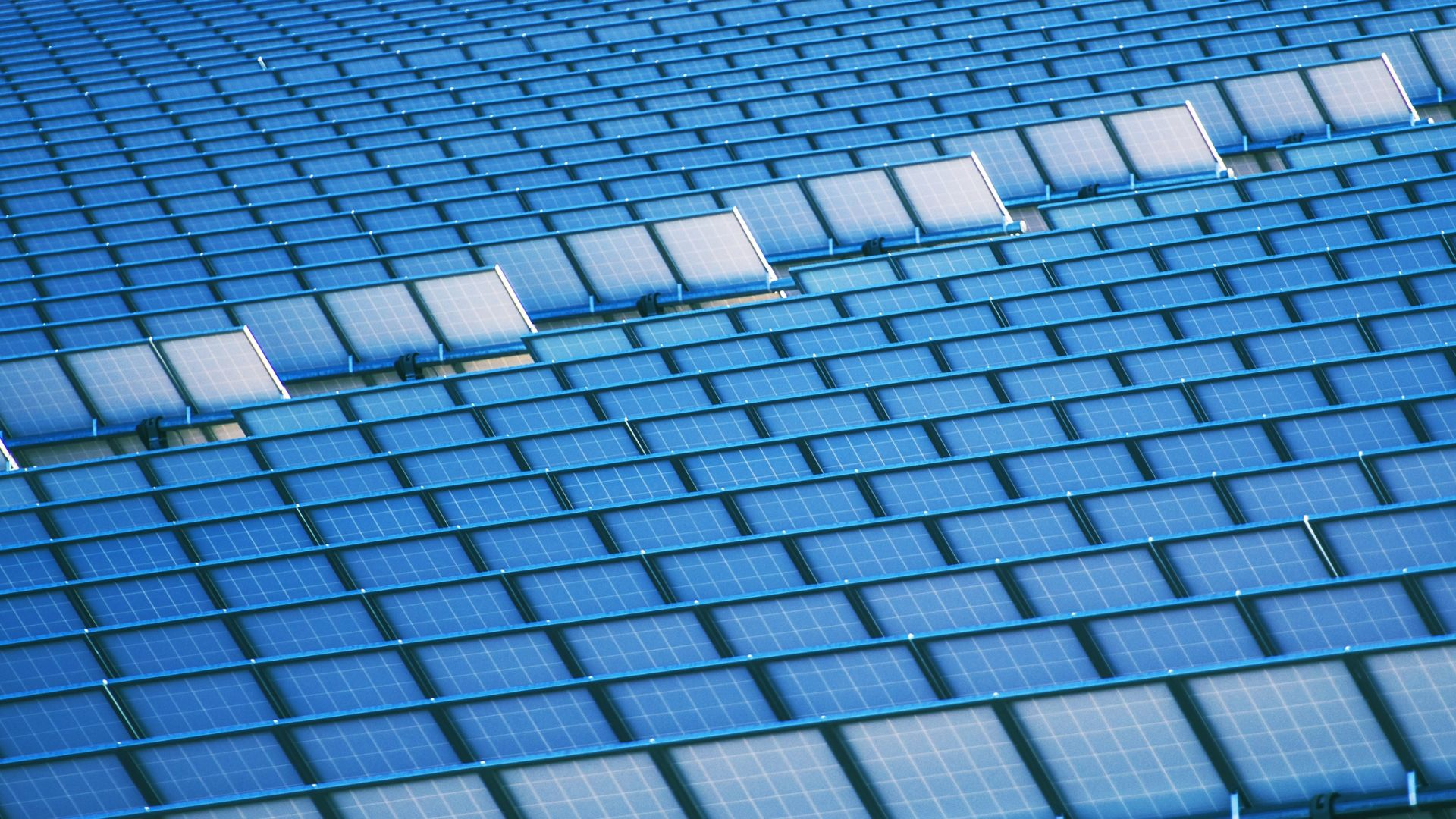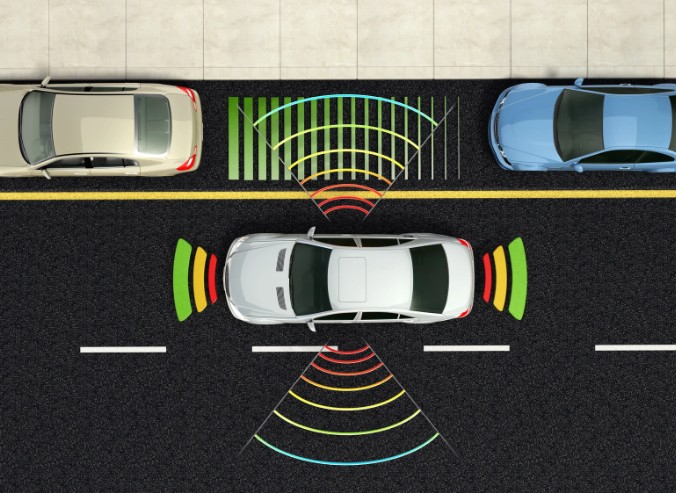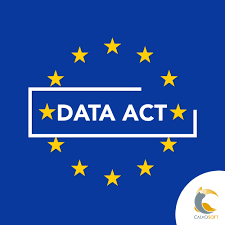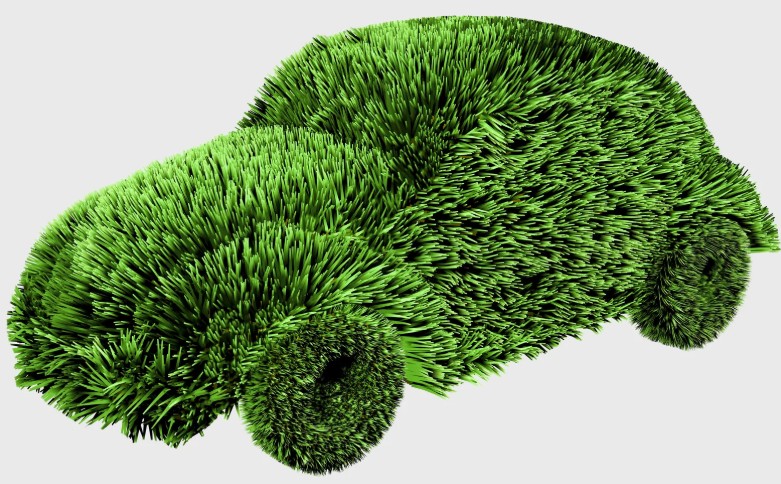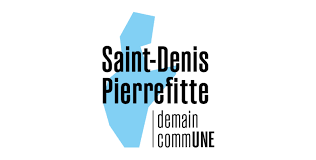Véritable scandale, l’affaire du Diesel Gate de Volkswagen a fait la lumière sur le greenwashing dans le secteur automobile. C’est en 2015 que l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a révélé les méthodes utilisées par le constructeur automobile allemand depuis 2009 compromettant l’exactitude des tests réalisés sur ses véhicules afin de vérifier leur respect des normes écologiques en vigueur[1]. Ce sont près de 11 millions de véhicules, dont 8,5 millions en Europe, qui furent ainsi concernés[2], pour lesquels Volkswagen n’avait pas hésité à communiquer sur leur caractère écologique.
En effet, face à une prise de conscience écologique croissante, le secteur des transports, et plus particulièrement la filière automobile, se trouve contrainte d’adapter ses stratégies marketing aux enjeux environnementaux. Or, ces dernières peuvent s’avérer parfois trompeuses pour le consommateur.
C’est ainsi que la multiplication des allégations environnementales trompeuses a conduit le législateur à se saisir de la question afin de l’encadrer, tant au niveau national qu’au niveau européen.
QU’EST-CE QUE LE GREENWASHING ?
Le greenwashing, ou « écoblanchiment » en français, correspond à la pratique consistant à donner une fausse impression de l’impact ou des avantages environnementaux d’un produit ou d’un service[3] en utilisant des allégations environnementales trompeuses.
Le Guide pratique des allégations environnementale publié par le Conseil National de la Consommation définit l’allégation environnementale comme un « un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit (bien ou service) ou son emballage ». [4]
L’allégation environnementale n’est pas condamnable en tant que telle. Elle ne le devient que lorsqu’elle est trompeuse, ce qui caractérise le greenwashing.
Il est notable que, dans le secteur automobile, le greenwashing concerne principalement les allégations environnementales relatives à l’absence ou au faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule mis en avant, telles que :« neutre pour le climat » ou « à zéro émission nette », qui sont, par leur manque de clarté ou de précision, susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.
Le greenwashing permet ainsi aux entreprises de promouvoir une image éco-responsable, dans un but lucratif ou attractif, vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs, de plus en plus attentifs à cette question, sans pour autant réellement s’engager dans la transition écologique.
Son caractère trompeur à l’égard des consommateurs et déloyal vis-à-vis des entreprises concurrentes, a poussé le législateur à se saisir du sujet.
Du fait de la multiplication des normes encadrant cette pratique, les entreprises encourent désormais un risque réputationnel et financier majeur rendant la communication environnementale de plus en plus difficile à articuler.
L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU GREENWASHING ET LES SANCTIONS
Le cadre juridique destiné à endiguer la pratique du greenwashing s’est progressivement développé au niveau national mais également européen, et s’est doté d’un solide dispositif de sanctions.
En effet, la lutte contre le greenwashing revêt également un intérêt économique dès lors que l’encadrement des allégations environnementales, -lesquelles sont devenues un facteur de compétitivité-, devrait permettre d’endiguer les actes de concurrence déloyale.
Dès 2021, la France est venue encadrer et sanctionner la pratique du greenwashing avec la loi Climat et Résilience (2.1.). Ce n’est toutefois que plus récemment que le législateur européen s’est saisi de la question (2.2.).
En France
L’encadrement juridique
Le législateur français est venu règlementer les allégations environnementales avec la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience »[5].
L’appréhension du greenwashing par l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses
Déjà en 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait sanctionné sur le fondement du délit des pratiques commerciales trompeuses le constructeur automobile General Motors pour une campagne publicitaire portant sur un véhicule hybride présenté comme « Plus écologique », dès lors que cette information était de nature à induire le consommateur en erreur[6].
Ce n’est toutefois qu’en 2021 que le législateur français a explicitement étendu le cadre juridique des pratiques commerciales trompeuses aux pratiques liées au greenwashing, lesquelles sont désormais interdites aux termes de l’article L. 121-2 b) et e) du Code de la consommation.
Ainsi, est qualifiée de trompeuse, la pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portantnotammentsur[7]:
- « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : (…) ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » ;
- « La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale (…) ».
L’appréhension du greenwashing par l’encadrement de l’usage des allégations environnementales dans la publicité
S’il existe de nombreuses dispositions qui encadrent les allégations environnementales en matière de publicité, nous nous concentrerons plus particulièrement sur celles qui s’appliquent au secteur automobile.
À cet égard, la loi « Climat et Résilience » est venue créer et/ou amender les articles suivants :
- L’article L.229-61 du Code de l’environnement qui interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles à l’exception des carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50% ;
- L’article L.229-64 du Code de l’environnement qui prévoit l’obligation d’afficher, au sein des publicités faites en faveur d’une voiture particulière, la classe d’émissions de CO2 ;
- L’article L.229-68 du Code de l’environnement qui interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public le bilan d’émissions de gaz à effet de serre, la démarche d’évitement, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre et les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
- L’article L.121-24 du Code de la consommation qui interdit toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (autrement appelée le « malus ») ;
Il faut également noter qu’à partir du 1er janvier 2028 la publicité relative à la promotion de l’achat des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sera interdite.
Cet arsenal législatif est en outre complété par la Recommandation « Développement Durable » de l’Autorité de Régulation de la Publicité (ARPP), qui récapitule toutes les bonnes pratiques à adopter pour faire valoir un argument écologique au sein d’une publicité[8], a fortiori dans le secteur automobile.
Bien que l’ARPP n’ait pas de pouvoir réglementaire, ses recommandations s’imposent aux professionnels du secteur, le visa de l’ARPP étant notamment devenu – en pratique – obligatoire pour tout publicité diffusée à la télévision.
N.B : Cet encadrement des allégations environnementales dans le cadre des publicités en faveur des véhicules automobiles vient s’ajouter à un encadrement des visuels pouvant être utilisés dans les publicités automobiles.
En effet, depuis 1994, les dispositions combinées des articles L.362-1 et L362-4 du Code de l’environnement interdisent toute forme de publicité présentant un véhicule « en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Il s’agissait déjà en 1994 de proscrire toute représentation susceptible de banaliser ou de valoriser des pratiques contraires à la protection de l’environnement.
Les sanctions
Les sanctions des pratiques commerciales trompeuses
Aux termes de l’article L. 132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit :
- à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ; ou
- à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ; ce taux étant porté à 80 % lorsque les pratiques relatives aux caractéristiques essentielles ou à la portée des engagements de l’annonceur reposent sur des allégations environnementales.
Les sanctions du non-respect de l’encadrement des allégations environnementales en matière de publicité
Aux termes des articles L.229-63, L.229-65 et L. 229-69 du Code de l’environnement, tout manquement aux règles applicables en matière de publicité est sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique ou 100 000 € pour une personne morale, étant précisé que ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à la publicité considérée comme illégale.
Ces dispositions peuvent par ailleurs être invoquées par des association de défense de l’environnement afin d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée à leur action par une publicité illégale, ces associations étant habilitées à agir en justice à ce titre par l’article L 142-2 du Code de l’environnement.
Enfin, au-delà du risque financier, le risque réputationnel n’est pas négligeable, les consommateurs accordant de plus en plus d’importance aux valeurs écologiques des entreprises proposant à la vente des biens et des services.
Ainsi, d’une part, une plainte peut être déposée devant le Jury de Déontologique Publicitaire, instance associée à l’ARPP, qui certes n’émet pas de sanction, mais donne des avis publics, qu’elle publie sur son site Internet et qui peuvent donner lieu, dans certains cas, à un communiqué de presse, voire à une communication sur les réseaux sociaux, usant ainsi de la pratique dite du « name and shame ».
D’autre part, émerge une sorte de « justice privée » sur les réseaux sociaux, par la création de comptes ou de « hashtags » qui se donnent pour objectif de dénoncer sur les réseaux les entreprises qui ne respectent la réglementation applicable à leur communication, notamment par l’intermédiaire de partenariats avec des influenceurs.
En Europe
Un encadrement juridique en construction
La règlementation européenne en matière de greenwashing s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (« European Green Deal »)[9], lequel prévoit l’engagement de lutter contre les allégations environnementales fausses. Cette lutte contre le greenwashing a également été érigée comme une priorité dans le cadre du nouveau plan d’action pour une économie circulaire[10] et du nouvel agenda du consommateur[11]. En somme, la lutte contre le greenwashing est au cœur de l’actualité européenne.
La Commission européenne a donc introduit une nouvelle directive (a.) ainsi qu’une proposition de directive (b.) destinées à la lutte contre le greenwashing. Ces règlementations fournissent un cadre plus strict favorisant la lutte contre le greenwashing.
La directive « anti-greenwashing »
La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024[12] est venue modifier la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, afin de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information.
L’un des apports notables de cette directive est la création de nouvelles définitions et notamment celle d’ « allégation environnementale », qui renvoie à « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps », ou encore de « label de développement durable ».
La directive vient par ailleurs interdire l’usage d’une série de termes quand ils ne sont pas suffisamment étayés.
Les Etats membre de l’Union européenne doivent transposer les dispositions modificatives des directives pour application au plus tard le 26 septembre 2026.
La proposition de directive « green claims »
La proposition de directive du 22 mars 2023 relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites[13], plus connue sous le nom de « directive sur les allégations environnementales », vise à compléter la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Parmi les dispositions de la proposition, peut être soulignée la volonté de fixer des exigences minimales en matière de justification et de communication d’allégations environnementales volontaires et de labels environnementaux concernant les pratiques commerciales des entreprises. Ainsi, elle viendrait permettre aux consommateurs d’accéder à des informations environnementales plus fiables, vérifiables et par conséquent comparables, afin de les protéger contre le greenwashing et de favoriser la prise de décisions d’achat en connaissance de cause.
Les sanctions à venir
Le législateur européen a prévu des sanctions destinées à lutter contre le greenwashing.
Si les Etats membres auront la charge de mettre en place des sanctions qui se devront d’être effectives, proportionnées et dissuasives lors de la transposition de la directive « anti-greenwashing », la Commission européenne propose des sanctions dans le cadre de la directive « green claims », à savoir l’exclusion des marchés publics, la perte de revenus ou encore une amende d’au-moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel[14].
Les outils de lutte contre le greenwashing déjà en place
Les nouvelles règlementations européennes, œuvrant pour la transparence et la promotion des pratiques éthiques, à savoir la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite directive « CSRD »[15] et la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite « CS3D »[16], sont d’autres outils de lutte contre le greenwashing.
En effet, la CSRD renforce l’obligation des entreprises de divulguer des informations extra-financières. Elle vise donc à renforcer la transparence et la comparabilité de l’information en matière ESG (« Environnement, Social et de Gouvernance »). En outre, la véracité de ces informations devra être vérifiée par un tiers indépendant.
La CS3D va, elle, imposer aux entreprises une obligation d’agir et de prendre des mesures afin de remédier aux impacts négatifs potentiels ou réels : il s’agit d’un devoir positif d’action dès lors qu’elles devront intégrer un devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise. Ainsi, ces entreprises évoluant dans le secteur des transports devront mettre en place des procédures d’évaluation des sous-traitants et des fournisseurs, selon certains critères, relatifs aux performances environnementale ou durable ou encore à la protection du climat.
Ainsi, le règlementaire vient au soutien d’une transparence réelle des informations environnementales et permet une comparaison fiable et loyale entre les entreprises. Des sanctions sont également mises en place par le législateur européen en cas de non-respect de ces règlementations.
ILLUSTRATIONS DU GREENWASHING
Si le greenwashing s’est bruyamment illustré dans le secteur automobile (3.1.), il est également très présent dans le secteur des transports (3.2.).
Dans le secteur automobile
Les exemples de greenwashing en matière automobile ne manquent pas.
Le secteur automobile a été marqué par le scandale du Diesel Gate de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand aurait trompé les consommateurs sur la qualité écologique de ses véhicules tout en mettant en avant son exemplarité en matière de mobilité compatible avec l’environnement.
Régulièrement des publicités de constructeurs automobiles sont par ailleurs épinglées au titre du greenwashing, notamment par le Jury de déontologie publicitaire, dès lors qu’elles ont laissé croire à l’idée de voitures éco-responsables[17].
Egalement, en 2022, au Mondial de l’Auto, des activistes ont dénoncé les pratiques de greenwashing du secteur automobile, consistant à promouvoir des voitures « plus écolos »[18].
Dans le secteur des transports
Le secteur des transports pris plus largement est l’un des secteurs les plus affectés par le greenwashing.
Au cours des trois dernières décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 33,5% dans le secteur des transports[19]. Paradoxalement, les acteurs des transports aérien, maritime, par route, sont particulièrement visés par les pratiques de greenwashing.
S’agissant du secteur aérien, il fait l’objet d’une actualité brulante : la Commission européenne ainsi que les autorités nationales de protection des consommateurs soupçonnent 20 compagnies aériennes d’avoir trompé des consommateurs concernant des projets climatiques censés compenser des émissions de CO² causés par leur vol. Auraient ainsi été recensées plusieurs allégations environnementales potentiellement trompeuses et donc condamnables au titre des pratiques commerciales déloyales[20].
Quant au secteur maritime, acteur majeur d’émissions de CO², il est également touché par le greenwashing. A titre d’exemple, il a été rapporté que l’armateur français CMA CGM utilisait du carburant au gaz naturel liquéfié, ou « GNL », affirmant que ce dernier est un carburant durable, permettant une réduction considérable des émissions de CO2 par conteneur, tout en passant sous silence les émissions de méthane, libéré par les cheminées, extrêmement nocif pour le climat[21].
En savoir plus
Le Conseil National de la Consommation a publié en 20223 un guide très complet à destination des consommateurs et des professionnels présentant de manière exhaustive l’encadrement des allégations environnementales et donnant des recommandations précises sur l’utilisation de certaines allégations environnementales.[22]
* Cet article a été publié dans le numéro de mars 2025 de la revue ‘Jurisprudence Automobile’. Il est co-rédigé par notre consoeur Safine Hadri, du Cabinet Kennedys Law, que nous remercions à cette occasion.
[1] V. Vienot de Vaublanc, Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés, La Croix, 3 septembre 2024, en ligne : Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés.
[2] Commission européenne, « Dieselgate », en ligne : «Dieselgate» – Commission européenne.
[3] Parlement européen, Ecoblanchiment : comment l’UE règlemente les allégations écologiques, 16 janvier 2024, mise à jour au 27 mars 2024, en ligne : https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20240111STO16722/ecoblanchiment-comment-l-ue-reglemente-les-allegations-ecologiques.
[4] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, Page 10, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf
[5] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en ligne : LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) – Légifrance.
[6] Cass. Crim., 21 octobre 2014, n°13-86.881, en ligne : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.881, Inédit – Légifrance.
[7] Article L. 121-2 du Code de la consommation.
[8] Recommandation Développement Durable v3, Autorité de Régulation de la Publicité, 1er août 2020, en ligne : https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/developpement-durable/
[9] Communication de la Commission, Le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final, en ligne : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640.
[10] Communication de la Commission, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et compétitive, Bruxelles, 11 mars 2020, COM(2020) 98 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098.
[11] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, Bruxelles, 13 novembre 2020, Com(2020) 696 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0696.
[12] En ligne : L_202400825FR.000101.fmx.xml.
[13] En ligne : IMMC.COM%282023%29166%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v2.docx.
[14] Article 17 de la proposition de directive du 22 mars 2023, en ligne.
[15] En ligne : L_2022322FR.01001501.xml.
[16] En ligne : L_202401760FR.000101.fmx.xml.
[17] Exemple : https://www.jdp-pub.org/avis/caocao-vehicule-publicitaire/
[18] Résistance à l’Agression Publicitaire, Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière, Communiqué de presse, 20 octobre 2022, en ligne : Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière – Résistance à l’Agression Publicitaire.
[19] Parlement européen, Emissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie), 22 mars 2019, mise à jour au 17 février 2023, en ligne : Émissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie) | Thèmes | Parlement européen.
[20] Commission européenne, La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses, Article d’actualité, 30 avril 2024, en ligne : La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses – Commission européenne.
[21] Transport & Environnement, Les déclarations en matière de développement durable du géant français du transport maritime mises en doute par une enquête, Communiqué de presse, 13 avril 2022, en ligne : Les déclarations en matière de… | Transport & Environment.
[22] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf